Rapport de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale

De nouvelles propositions pour l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique
Un rapport d’information (n° 1525) a été déposé le 5 juin 2025 par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.
Ce rapport présenté par les députés Philippe FAIT et Fabrice BARUSSEAU, issu des travaux de la mission d’information sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique, a pour objet d’ « éclairer les enjeux de l’adaptation au changement climatique et formuler des recommandations pour intégrer cette préoccupation dans les politiques publiques ».
Rappelant que la lutte contre le changement climatique repose sur la mise en œuvre conjointe de politiques d’atténuation[1] et de politiques d’adaptation[2], le rapport invite à développer un « réflexe adaptation » dans toutes les politiques publiques et relève que : « L’ensemble du droit de l’urbanisme doit être repensé pour éviter la maladaptation, notamment dans les zones à risques ».
Les rapporteurs formulent plusieurs propositions, concernant pour l’essentiel les acteurs locaux, et retiennent 10 propositions principales :
Proposition n° 1 : Consacrer dans la partie législative du code de l’environnement l’existence de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc)[3] ;
Proposition n° 6 : Rétablir un lien direct entre l’évolution de la surprime et les ressources allouées au fonds Barnier en rehaussant de 12 % à 20 % le taux de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts ;
Proposition n° 14 : Consacrer dans la partie législative du code de l’environnement l’existence d’un plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc) révisé tous les cinq ans ;
Proposition n° 17 : Généraliser la formation des élus locaux en début de mandat aux enjeux de transition écologique et plus spécifiquement d’adaptation afin de développer la culture du risque ;
Proposition n° 25 : Renforcer les effectifs du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) dédiés à l’adaptation au changement climatique afin d’accompagner le plus de collectivités territoriales possible dans la réalisation de leurs stratégies locales d’adaptation au sein de leur plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Ces recrutements supplémentaires pourraient être financés en réduisant les postes de chargé de mission transition écologique et adaptation au sein des collectivités territoriales en redirigeant les aides de l’agence de la transition écologique (Ademe) à cette fin ;
Proposition n° 36 : Préciser à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique que, dans le cadre des marchés publics, le critère du prix ou du coût, fondé sur l’entièreté du cycle de vie du produit, prend en compte le climat futur et les coûts associés pour cet investissement ;
Proposition n° 53 : Mettre fin au principe de la reconstruction à l’identique. Pour cela, prévoir une dérogation au principe indemnitaire en zone à risque pour permettre, voire imposer, à l’assureur de financer des travaux de prévention à la suite de sinistres reconnus Cat Nat, même au-delà de la valeur du bien assuré ;
Proposition n° 71 : Mettre en place une péréquation horizontale des revenus de la taxe Gemapi à l’échelle du bassin hydrographique, afin de permettre aux EPCI les plus exposés et les moins bien dotés de bénéficier de la solidarité des territoires à fort potentiel fiscal et moins à risque ;
Proposition n° 85 : Créer un fonds érosion côtière alimenté par une taxe sur les plateformes de location touristiques de courte durée et par la taxe sur les éoliennes maritimes ;
Proposition n° 94 : Intégrer au dispositif MaPrimeRénov’ les gestes permettant d’améliorer l’habitabilité lors des fortes chaleurs dans le cadre des rénovations d’ampleur.
Par ailleurs, le rapport propose de créer un « droit de préemption pour l’adaptation au changement climatique » (proposition n° 45).
Ce droit de préemption pourrait être institué dans les territoires couverts par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale seraient les titulaires de ce nouveau droit de préemption.
Après avoir rappelé le droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte créé par la loi climat et résilience[4], le rapport souligne que ce droit n’a « été créé que face à une seule conséquence du changement climatique, le recul du trait de côte. Or il convient de déplacer des biens et activités menacés par d’autres effets du changement climatique, notamment en zone inondable ».
Les rapporteurs proposent ainsi la création d’un nouveau droit de préemption, qui pourrait être exercé afin de réaliser un projet visant l’adaptation au changement climatique des territoires couverts par un PPRN.
[1] Pour rappel, l’article 2, 1, a) de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 fixe pour objectif de limiter le réchauffement mondial nettement en dessous de 2 °C par rapport à l’ère pré-industrielle et de poursuivre les efforts afin de ne pas dépasser 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
[2] La lutte contre le changement climatique repose également sur un troisième pilier, que constitue la réparation des pertes et préjudices prévue par le mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatique. Ce mécanisme a été adopté par la décision de la Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques n° 2/CP.19 du 23 novembre 2013.
[3] Le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc-3) publié le 10 mars 2025 fixe la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) suivante : la France à + 2 °C en 2030, à + 2,7 °C en 2050 et à + 4 °C à 2100.
[4] Article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Revisiter la propriété : Focus sur la propriété collective des sections de communes

Définition. Survivance de l’ancien régime, consacrant une forme de propriété collective à l’échelon infra-communal, les biens et droits sectionaux sont des biens meubles ou immeubles (pâturages, forêts, drailles, machines agricoles, etc.) et des droits réels (forestage, affouage, chasse, etc.) détenus « à titre permanent et exclusif par toute partie d’une commune » appelée alors « section de commune » (article L2411-1 CGCT ). Entités infra-communales disposant de leur propre personnalité juridique de droit public (patrimoine distinct, capacité d’ester en justice, de conclure des contrats, etc.) les sections de commune ont vocation à administrer, avec le Conseil municipal et le Maire, les biens et droits sectionaux dont ils sont propriétaires. (CE, 1er oct. 1986, n° 59522, Cne Saulsotte).
Depuis 2013, aucune nouvelle section de commune ne peut être créée (volonté de rationaliser la gestion foncière locale), cependant cette forme de propriété demeure, notamment en territoires ruraux.
Membres. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. Ils sont dénommés les « ayants-droits de la section de commune ».
Si le droit de propriété des biens sectionaux appartient indivisiblement à la seule section, ses membres disposent néanmoins d’un véritable droit de jouissance sur les biens sectionaux dont les fruits sont perçus en nature (par ex. droit de pâturage, droit d’affouage…) à l’exclusion de tout revenu en espèce (article L.2411-10 CGCT).
Gestion des biens. La gestion des biens sectionaux relève en principe de la seule compétence partagée du Conseil Municipal et du Maire de la commune. Toutefois, au sein d’une section de commune, un organe de gestion dénommé « commission syndicale » peut être créé, après chaque élection municipale, à la demande de la moitié des électeurs de la section (membres de la sections inscrits sur les listes électorales) ou du Conseil municipal, par arrêté du Préfet du département, après convocation des électeurs de la section.
Certaines situations (faible nombre d’électeurs, électeurs récalcitrants, faibles revenus annuels de la section) font obstacle à la création d’une commission syndicale (article 2411-5 CGCT). Outre le Maire, cette dernière comprend des représentants élus des membres de la section (4 à 10 membres) et un président élu parmi eux. Lorsqu’elle est créée, la commission syndicale partage avec le Conseil municipal et le Maire la gestion des biens sectionaux.
Partage des compétences relatives à la gestion des biens sectionaux
Ressortissent à la compétence de la commission syndicale lorsqu’elle existe, notamment : la passation des contrats avec la commune de rattachement ou une autre section communale ; la vente, l’échange et la location des biens sectionaux pour une ≥ à 9 ans ; le changement d’usage des biens, l’acceptation des libéralités, transactions et actions judiciaires (article L.2411-6 CGCT).
Ressortissent à la compétence du Conseil municipal : La vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation d’un lotissement ou à l’exécution d’une opération d’intérêt public ; la location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ; l’adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière. La commission est consultée pour avis sur tout projet de délibération afférant à l’exercice de ces compétences (articles L.2411-5 et L.2411-6 CGCT).
Lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée, les compétences de gestion qui lui sont normalement dévolues sont exercées par le Conseil municipal (articles L.2411-5 et L.2411-6 CGCT).
Régime financier. Le budget de la section communale, qui constitue un budget annexe de la commune, est préparé par la commission syndicale puis soumis pour adoption au Conseil municipal, lequel peut y apporter des modifications. Il est nécessairement voté en équilibre.
En l’absence de constitution d’une commission syndicale, il n’est pas établi de budget annexe, et les soldes de fin d’exercice sont repris l’année suivante au budget de la commune. Un « état spécial » annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section est alors établit dans ce cas par le Conseil municipal. La section communale ne dispose pas de pouvoir financier autonome, le maire reste l’ordonnateur des dépenses de la section.
Les revenus en espèces tout comme le produit de la vente des biens de la section ne peuvent être utilisées que dans l’intérêt de la section (articles L.2411-10 et L.2411-17).Ils sont prioritairement affectés notamment à l’entretien et la mise en valeurs des biens sectionaux. En cas d’utilisation contraire aux intérêts de la section, les membres de la section sont fondés à agir contre la commune (CE, 1er oct. 1986, n° 59522, Cne Saulsotte).
Transfert des biens sectionaux à la commune. Certaines situations peuvent justifier le transfert des biens sectionaux aux communes (désintérêt caractérisé des membres de la section, non constitution de la commission syndicale, mise en œuvre d’un objectif d’intérêt général, etc.) Il est prononcé par arrêté préfectoral.
L’ordonnance d’expropriation : une garantie au service de l’utilité publique

Par un arrêt du 28 mai 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle la compétence liée des juges de l’expropriation appelés à se prononcer sur le transfert de propriété.
En l’espèce, l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) faisait grief au juge de l’expropriation d’avoir refusé de prononcer le transfert de propriété de plusieurs parcelles au motif que « la procédure de délaissement ayant été diligentée antérieurement à la procédure d’expropriation, elle ne peut être considérée comme étant sans objet au jour de la signature de l’ordonnance d’expropriation. »
Pour mémoire, le droit de délaissement peut être défini comme la faculté offerte aux propriétaires d’un bien, concerné par une opération d’urbanisme, d’obliger l’expropriant du projet à acquérir ledit bien (1).
La Cour de cassation rappelle d’abord les dispositions relatives à l’office du juge de l’expropriation saisi d’un dossier d’expropriation transmis par le préfet, prévues aux articles L.221-1, R.221-2 et R.221-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Elle en déduit ensuite ce que le Conseil constitutionnel avait déjà relevé dans une décision du 16 mai 2012 : « le juge de l’expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique »(2).
La Haute juridiction en conclut que dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales, le transfert de propriété, « peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement. »
L’ordonnance refusant l’expropriation est par voie de conséquence cassée et annulée.
Cette décision témoigne de l’équilibre voulu par le législateur entre les droits des expropriés (droit de délaissement), mais aussi les impératifs de l’utilité publique qui justifient de ne pas retarder une ordonnance d’expropriation lorsque les conditions de son édiction sont remplies.
(1) Article L.311-2 du code de l’urbanisme
(2) Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-247 QPC
Enfin un droit de visite en préemption Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Le décret n° 2025-426 du 13 mai 2025, publié le 15 mai 2025 au Journal officiel de la République française (JORF n° 0113 du 15 mai 2025), fixe les conditions de visite d’un bien par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.
L’article 234 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets avait modifié les dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme, en permettant au titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles de demander à visiter le bien faisant l’objet d’une aliénation soumise à ce droit.
Le décret du 13 mai 2025, adopté pour l’application de l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme issu de la loi du 22 août 2021, insère un article D. 215-11-1 dans le code de l’urbanisme.
Les conditions de visite fixées par le décret du 13 mai 2025 sont celles prévues pour le droit de préemption urbain par les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 du code de l’urbanisme :
- La demande de la visite du bien est faite par écrit.
- Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
- Le délai de trois mois reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.
- L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.
- Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite.
- La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
- Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d’informer de l’acceptation de la visite les occupants de l’immeuble mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
- Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.
- L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai reprend son cours.
- Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
- Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite.
- La demande de la visite du bien visée indique les références de la déclaration d’intention d’aliéner. Cette demande reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l’article L. 215-14 et celles des articles 213-13-2 et D. 213-13-3.
- Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite.
- Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier.
L’article 2 du décret précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux déclarations d’intention d’aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret, à savoir le 16 mai 2025.
Expropriation – En deux décisions du 16 janvier 2025, la Cour de Cassation a significativement fait évoluer les règles applicables au contentieux de l’expropriation.
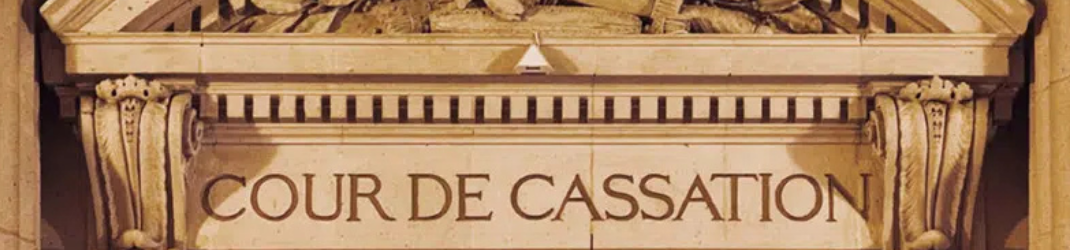
- Décision n°23-21.174 : la fin de l’annulation des ordonnances d’expropriation par voie de conséquence de l’annulation de la DUP ou de l’Arrêté de cessibilité
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025, n° 23-21.174)
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a fixé une nouvelle procédure concernant les voies de recours ouvertes contre une ordonnance d’expropriation (articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l’expropriation).
Avant cette décision, il était admis qu’un exproprié puisse former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de transfert de propriété avant même que le juge administratif ne se soit prononcé sur l’annulation définitive de la DUP ou l’arrêté de cessibilité, et demande à l’occasion de ce pourvoi l’annulation de l’ordonnance par voie de conséquence de l’annulation à intervenir de l’un ou l’autre de ces actes de la phase administrative (Cass. 3 civ., 17 décembre 2008, n° 07-17.739).
Après avoir constaté que le recours en perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation (L. 223-2 et R. 223-1 et s. code expr.) est de nature à pleinement garantir les droits des expropriés, la Cour de cassation a décidé que l’annulation à intervenir d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté de cessibilité ne pourra désormais plus permettre à un exproprié de former un pourvoi contre une ordonnance d’expropriation. Cette décision est d’application immédiate.
L’annulation de l’arrêté de cessibilité ou de la DUP ne peuvent désormais plus qu’être soulevés à l’occasion d’un recours en constatation de perte de base légale, formé dans un délai de 2 mois à compter de la décision définitive, et adressé au juge de l’expropriation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2025, 23-21.174, Publié au bulletin
- Décision n°23-20.295 : la tardiveté de la communication de pièces en appel n’est plus une cause de caducité
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025 n°23-20.925)
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de Cassation a réduit les conséquences de la tardiveté de la transmission de pièces par l’appelant, cette tardiveté induisant l’irrecevabilité des pièces mais n’entraînant plus la caducité de l’appel.
La Cour d’appel de Poitiers avait, dans un arrêt du 7 juillet 2023, déclaré caduc l’appel interjeté par des propriétaires en ce qu’ils avaient transmis au greffe les pièces visées dans leurs conclusions postérieurement au délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure, délai qu’ils avaient pourtant respecté.
Cet arrêt s’inscrivait dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle, en matière d’expropriation, l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l’expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel (3e Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346), y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-50.039 ; 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.078).
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2025, opère un revirement de jurisprudence en jugeant que :
« la caducité de la déclaration d’appel n’est encourue que lorsque l’appelant n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n’étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La Cour précise, en outre, que « l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’est encourue que lorsque celui-ci n’a pas conclu dans le délai prévu par le même texte, la communication tardive des pièces n’étant sanctionnée que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Ces nouvelles règles de procédure, fondées sur le droit d’accès au juge tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont d’application immédiate.
Classement 2024 Décideurs Magazine:TH Avocats, leader en Maîtrise Foncière!

[DISTINCTION 🔝] Sortie des classements Energie, Environnement, Acteurs Publics édition 2024 !
En cette période où l’on regarde à la fois dans le rétroviseur (quelle année bien remplie !) et vers l’avenir (de beaux projets en cours !), nous avons reçu deux nouvelles réjouissantes cette semaine :
➡️L’attribution par l’EPF Ile-de-France des deux lots du marché de conseil et de représentation en justice de l’EPFIF en matière foncière et immobilière.
🏆 Le classement des Décideurs présentant le cabinet TH AVOCATS comme LEADER 2024 en MAÎTRISE FONCIERE.
Présent depuis de nombreuses années parmi les cabinets référencés par le magazine Décideurs dans le guide « Énergie, environnement, acteurs publics & entreprises, TH AVOCATS, pour cette nouvelle édition 2024, est distingué dans les catégories suivantes :
👉 MAÎTRISE FONCIÈRE – Incontournable
👉 DOMANIALITÉ PUBLIQUE – Forte notoriété
👉 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES & ECONOMIE MIXTE – Forte notoriété
👉 URBANISME & AMÉNAGEMENT – Forte notoriété
👉 DROIT DES GRANDS ENSEMBLES (COPROPRIÉTÉ) – Forte notoriété
👉 DROIT DES BAUX – Forte notoriété
👉 DROIT DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – Pratique réputée
👉 ICPE, SITES ET SOLS POLLUÉS, FRICHES INDUSTRIELLES – Pratique réputée
👉 CONTRATS ADMINISTRATIFS ET CONTENTIEUX AFFÉRENTS – Pratique de qualité
🙏De nouveau, TH AVOCATS tient à remercier vivement l’ensemble de ses équipes toujours investies et engagées dans la réussite de l’ensemble de nos missions et projets ainsi que nos clients et partenaires qui nous renouvellent quotidiennement leur confiance pour accompagner leurs projets.
Le Conseil constitutionnel précise l’interprétation des textes relatifs au droit de rétrocession des propriétaires de biens cédés sous DUP

Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024
Par une décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024 (NOR : CSCX2431609S, JORF n°0277 du 23 novembre 2024, Texte n° 59), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives aux modalités d’exercice du droit de rétrocession.
L’article L. 421-1 du code de l’expropriation dispose que :
« Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. »
L’article L. 421-3 du même code prévoit toutefois, à peine de déchéance du droit de rétrocession, que :
« le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. »
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision commentée, une opération d’aménagement avait été déclarée d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 8 novembre 1993.
Par acte notarié[1] du 1er août 1994, l’expropriant avait acquis des terrains situés dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique.
En l’absence d’affectation dans le délai prévu, le tribunal de grande instance de Thionville, par un jugement du 15 février 2013, en avait ordonné la rétrocession.
Le prix de rétrocession avait été fixé par un jugement du 14 novembre 2019, rectifié par un jugement du 19 mars 2020.
Le 13 octobre 2020, l’expropriant avait notifié aux intéressés la déchéance de leur droit de rétrocession en application de l’article L. 421-3 du code de l’expropriation.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante.
« L’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 ainsi que par l’article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ? »
Après avoir déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle alléguait la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour a considéré que la question, en ce qu’elle visait les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présentait un caractère sérieux (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, n° 24-40.013).
La Cour a d’abord rappelé la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-292 QPC en date du 15 février 2013 selon laquelle:
« en instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée ».
Faisant application de l’intention du législateur telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a estimé que la disposition contestée était susceptible de priver d’effectivité l’exercice du droit de rétrocession et, par suite, de porter atteinte au droit de propriété, au motif que la sanction de déchéance s’appliquait nonobstant l’accomplissement de diligences par le titulaire du droit de rétrocession ou une éventuelle inertie de l’autorité expropriante.
La Cour a ensuite indiqué que cette atteinte pouvait être considérée comme disproportionnée au motif que le délai d’un mois paraissait incompatible avec les délais usuels d’établissement d’un acte authentique et, le cas échéant, de souscription d’un prêt bancaire.
La question a été transmise au Conseil constitutionnel le 10 septembre 2024, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Après avoir siégé en audience publique le 13 novembre 2024 dans les locaux de la cour d’appel de Rennes[2], le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 421-3 du code de l’expropriation conforme à la Constitution en formulant une réserve d’interprétation.
Le Conseil constitutionnel a d’abord observé que l’encadrement de l’exercice du droit de rétrocession par l’article L. 421-3 du code de l’expropriation vise à prévenir l’inaction de son titulaire.
Relevant que ce délai court, une fois que l’intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter d’un accord sur le prix ou une décision de justice, le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession.
Dans le point 9 de sa décision, le Conseil constitutionnel pose néanmoins la réserve d’interprétation suivante : les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’expropriation ne peuvent être interprétées comme permettant la déchéance du droit de rétrocession lorsque le non-respect du délai prescrit n’est pas imputable à son titulaire.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’expropriation ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de l’article 17 de la Déclaration de 1789, écarte le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences et déclare conformes à la Constitution les dispositions contestées.
L’article 62 de la Constitution relatif à l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’appliquant aux réserves d’interprétation[3], le juge judiciaire, compétent pour connaître des modalités d’exécution de la rétrocession (Tribunal des conflits, 12 janvier 1987, , Préfet de l’Aveyron, n° 2445 bis), devra tenir compte des diligences accomplies par le titulaire du droit de rétrocession et de l’éventuelle inertie de l’autorité expropriante.
Le juge devra écarter l’opposabilité de la déchéance dès lors que le défaut de signature du contrat de rachat ou de paiement du prix dans le mois de sa fixation n’est pas imputable au titulaire du droit de rétrocession.
[1] Le droit de rétrocession est applicable aux biens acquis par cession amiable après déclaration d’utilité publique (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 avril 1970, n° 68-10.927 ; Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 2001, n° 99-13.507) ou antérieurement à la déclaration d’utilité publique et dont il a été donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.972).
[2] Le Conseil constitutionnel a indiqué que : « Cette onzième audience publique hors les murs répond à la volonté du Président Laurent Fabius de faire mieux connaître le Conseil et ces « questions citoyennes » que sont les questions prioritaires de constitutionnalité. » (Conseil constitutionnel, Audience publique de question prioritaire de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel siège à Rennes le 13 novembre 2024, Actualité, 28 octobre 2024).
[3] M. Guillaume, L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel : vers de nouveaux équilibres ?, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 30, Dossier : Autorité des décisions, janvier 2011.
Recrutement Avocat Collaborateur Junior (F/H) Paris

Afin d’accompagner notre développement 🚀, nous recrutons un/une avocat/avocate junior en foncier public et aménagement.
Sous la responsabilité d’un associé et en collaboration avec les avocats/juristes de l’équipe, et les partenaires du cabinet (financiers, urbanistes, économistes de l’aménagement), vous serez amené à travailler sur des sujets fonciers et immobiliers publics et/ou privés.
Vos missions :
✅Conseils en suivi de procédures administratives (préconisations stratégiques, rédactions de projets de décisions administratives, etc.)
✅Suivi de dossiers contentieux devant les juridictions administratives et/ou judiciaires (notamment juridictions de l’expropriation)
✅Assistance à la négociation et établissement de protocoles
✅Participation aux actions de formation et de communication du cabinet
✅Veille juridique
Profil recherché :
- Formation : en Master II Droit public ou Urbanisme/aménagement
- Expérience souhaitée de 0 à 3 ans : Vous avez idéalement une expérience préalable en cabinet d’avocats en droit : de l’action foncière publique (expropriation, préemption), de la domanialité, de l’urbanisme, de l’environnement, de l’immobilier privé ou notarial.
- Qualités : Sens de l’organisation et dynamisme, capacité à travailler de manière autonome et en équipe, fortes compétences en communication verbale et écrite, aisance sur le pack Office
Poste à pourvoir dès janvier 2025
Localisation Paris
Rejoindre notre cabinet, c’est l’opportunité d’intégrer une équipe dynamique où la confiance et les bonnes relations humaines, vous offrent la possibilité d’évoluer dans un cadre d’environnement stimulant, innovant et ambitieux.
Pour plus d‘informations et envoyer votre candidature, écrivez nous à :
📩 com@thavocats.fr
Offre de poste Avocat Collaborateur (F/H)

Afin d’accompagner notre développement, nous recrutons un/une avocat/avocate en droit public, contrats publics et aménagement.
Sous la responsabilité d’un associé et en collaboration avec les avocats/juristes de l’équipe, et les partenaires du cabinet (financiers, urbanistes., économistes de l’aménagement.), vous serez amené à travailler sur des sujets contractuels en lien avec des opérations d’aménagement, de renouvellement urbain, des projets immobiliers publics et/ou privés.
Vos missions :
- Conseils portant sur des projets et opérations publiques (Choix du montage contractuel, du mode de gestion d’un site, d’un service public, définition des modalités de gouvernance, rédactions de contrats, de décisions administratives, etc.)
- Conseils en pré-contentieux (analyses de risques, préconisations)
- Assistance à la négociation et établissement de protocoles
- Suivi de dossiers contentieux devant les juridictions administratives et/ou judiciaires
- Participation aux actions de formation et de communication du cabinet
- Veille juridique
Poste à pourvoir dès janvier 2025
Localisation Rennes ou Paris
Formation en Master II Droit public (contrats publics)
Expérience souhaitée d’un 1 à 3 ans en droit des contrats public acquise en cabinet d’avocats.
Rejoindre notre cabinet, c’est l’opportunité d’intégrer une équipe dynamique où la confiance et les relations humaines, vous offrent la possibilité d’évoluer dans un cadre d’environnement stimulant, innovant et ambitieux.
Pour plus d‘informations et envoyer votre candidature, écrivez nous à contact@thavocats.fr
Cession du Stade de France et mise en concurrence préalable : un rappel bienvenu

Par une ordonnance rendue le 15 mai 2024 dans le cadre d’un référé précontractuel, le Tribunal administratif de Montreuil s’est prononcé sur la régularité d’une procédure de mise en concurrence préalable mise en œuvre dans le cadre de la cession, avec charges, d’un bien immobilier de l’Etat.
Dans le cadre de la cession du Stade de France, son propriétaire, l’Etat, a lancé deux procédures d’appel d’offres portant, pour l’une, sur la concession du Stade, et pour l’autre, sur la cession du Stade avec charges. Le groupement « Le Stade de France – notre bien commun » avait alors déposé un dossier de candidature pour l’acquisition du Stade. Son offre a été rejetée par l’Etat.
Le groupement a alors saisi le juge administratif par la voie d’un référé précontractuel (L. 551-1 du code de justice administrative) pour lui demander de reprendre la procédure de mise en concurrence organisée dans le cadre de la cession du Stade et d’annuler la décision de l’Etat par laquelle il avait rejeté l’offre du candidat.
Le juge administratif a décidé :
- Que la juridiction administrative était bien compétente en vertu des dispositions de l’article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui disposent que tous les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat sont portés devant la juridiction administrative ;
- Que le juge des référés précontractuels n’était pas compétent, en l’espèce, pour statuer sur la demande présentée par le groupement. Le juge, après une analyse des conditions de la procédure de mise en concurrence et des modalités du futur contrat, et notamment des charges qui sont imposées au futur acquéreur, conclut que le contrat ne pouvait pas être qualifié de contrat de la commande publique (inexistence d’un « besoin » de l’Etat). Le juge des référés précontractuels n’étant compétent que dans le cadre des procédures impliquant des contrats de la commande publique, rejette logiquement sa compétence.
Cette décision rappelle que les procédures de mise en concurrence préalables à la conclusion d’un contrat passé par au moins une personne publique ne relèvent pas d’un seul et même régime. Il convient de distinguer :
- Les procédures de mise en concurrence mises en œuvre dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, soumises aux règles du code de la commande publique ;
- Les procédures de mise en concurrence mises en œuvre dans le cadre de la passation d’autres contrats « publics » (conventions d’occupation, cessions de biens immobiliers, etc.), qui sont librement organisées par les personnes publiques, à condition, d’une part, d’instaurer une concurrence effective, et, d’autre part, que le contrat concerné ne soit pas requalifiable en contrat de la commande publique, auquel cas les règles du code de la commande publique auront vocation à s’appliquer.
Rappelons, pour conclure, que la cession des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat est obligatoirement consentie après publicité et mise en concurrence préalable (R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques). Ce n’est pas le cas des biens immobiliers du domaine privé des collectivités territoriales, qui peuvent néanmoins y procéder volontairement.